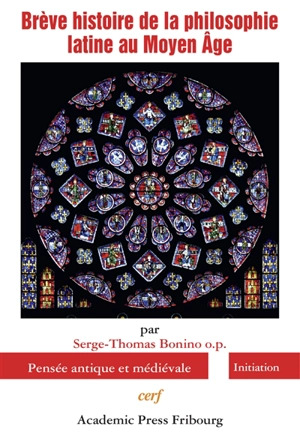Le livre de Serge-Thomas Bonino a d’abord un objectif pédagogique, celui de « dégrossir les débutants », en offrant un « aperçu panoramique de l’histoire de la philosophie dans l’Occident latin pendant le millénaire qui va du VIe au XVe siècle » (p. v). Mais cette présentation se fait selon le choix d’un thème directeur qui a une portée doctrinale, celui du rôle joué par la Révélation dans cette histoire, la foi chrétienne et la raison n’étant pas en soi exclusives l’une de l’autre, mais pouvant, sans séparation ni confusion, se féconder mutuellement : « Dans cette perspective, l’histoire de la philosophie médiévale est un excellent observatoire pour penser la question des rapports entre la foi et la raison, qui est une des figures majeures de la question, déterminante pour la sagesse chrétienne, du rapport de la grâce et de la nature » (p. vii).
L’A. commence par définir la nature exacte de la philosophie médiévale (chap. 1), à partir d’un panorama présentant les différentes manières dont elle a été conçue au cours de l’histoire. Après le discrédit qu’elle subit à la Renaissance puis à l’époque des Lumières, elle connaît une certaine réhabilitation au XIXe siècle, sous l’influence du romantisme, mais qui n’est pas sans ambiguïté, les rationalistes y cherchant les prémices de l’esprit moderne affranchi de l’autorité ecclésiale, et les catholiques y voyant l’âge d’or d’une pensée préservée des erreurs de la modernité. Ces deux interprétations donnent naissance à la querelle des années 1930, opposant principalement Bréhier et Heidegger, rejoints par certains catholiques partisans d’une séparation radicale entre la philosophie et la foi, au nom de l’autonomie de la première, à Gilson et Maritain. Ceux-ci affirment au contraire l’existence d’une philosophie proprement chrétienne, au double sens d’« une manière spécifiquement chrétienne de philosopher » et de « la constitution d’un corps de doctrines philosophiques dégagées grâce à l’influence déterminante du christianisme » (p. 5), distincte par nature de la théologie, mais se développant sous sa lumière. Cette approche a le mérite de tenir compte du fait que l’on ne philosophe jamais de manière intemporelle, mais dans un contexte historique déterminé et au sein d’une tradition, fût-ce pour s’y opposer. Le chapitre se termine par l’exposé des quatre grandes tendances de la recherche actuelle que l’A. présente « comme une réaction face au modèle gilsonien longtemps dominant » (p. 13). Sans nier l’influence du christianisme sur la philosophie médiévale, elle en souligne aussi un développement distinct de la théologie, au sein de la faculté des arts en particulier. Elle élargit le champ d’étude aux domaines de la logique et des arts du langage, moins marqués par la foi que la métaphysique, et aux époques qui précèdent ou suivent le XIIIe siècle, sur lequel se centrait Gilson, comme étant l’âge d’or de la pensée médiévale en raison du primat de la métaphysique. Enfin, elle dissocie l’histoire de la philosophie qu’il unissait étroitement. Tout en reconnaissant les apports indéniables de ces nouvelles perspectives, l’A. conclut le chapitre en soulignant ses limites : « Une approche plus “catholique” se doit de prendre en compte ces précieux renouvellements mais sans négliger pour autant les acquis du médiévisme classique “à la Gilson” qui avait l’avantage d’être plus libre à l’égard du souci, somme toute très extrinsèque, de faire accepter les études médiévales dans une culture laïque allergique à toute trace de la dimension religieuse de l’existence humaine. De ce point de vue, la pensée médiévale reste un signe de contradiction » (p. 16). L’A. poursuit par une présentation des grandes lignes de la pensée augustinienne, en raison de son rôle déterminant sur toute la pensée médiévale, tout en soulignant le peu de place qu’elle laisse à l’ordre naturel et à la raison humaine (chap. 2).
Il peut alors aborder l’histoire médiévale proprement dite avec la période du haut Moyen Âge (chap. 3), qui se caractérise d’abord par le souci de transmettre ce qu’il est possible de la philosophie antique, et de la faire servir à l’intelligence de la foi, Boèce en étant le plus illustre représentant. Au IXe siècle, émerge la figure de Jean Scot Érigène qui découvre la théologie grecque, traduisant en particulier Denys l’Aréopagite dont il introduit la pensée dans le monde latin, et théorise la question des relations entre la réflexion rationnelle guidée par la foi, et les autorités patristiques dans l’interprétation de l’Écriture.
Après les difficultés dues aux invasions et à l’effondrement de l’empire carolingien, la philosophie se développe au sein des monastères puis des écoles cathédrales (chap. 4), la question dominante devenant au milieu du XIe siècle celle de l’articulation entre « la dialectique et l’intelligence de la foi » (p. 50), à propos des discussions eucharistiques provoquées par l’hérésie de Bérenger de Tours, d’où la méfiance que peut susciter son emploi en théologie, et qui sera l’enjeu du débat opposant « l’école et le cloître » (chap. 5) : « Le conflit entre Bernard et Abélard est le symbole du choc de deux mondes comme de deux conceptions de la sagesse chrétienne qui s’affrontent au XIIe siècle. D’un côté, l’univers des écoles urbaines où prend corps cette théologie à prétention scientifique qu’on appellera scolastique et dont Abélard est l’un des initiateurs. De l’autre, l’univers, surtout rural, des monastères […], où, parce qu’on est très attentif au contexte spirituel de l’intelligence de la foi, on s’inquiète des orientations trop distanciées et raisonneuses qu’elle prend parfois dans les écoles » (p. 65).
L’A. introduit l’histoire du XIIIe siècle par la présentation des « conditions générales de la vie intellectuelle » (chap. 6), expliquant le tournant opéré : naissance et développement des Universités puis des ordres mendiants du côté des institutions, confrontation de la pensée chrétienne avec la philosophie et la science gréco-arabes sur le plan intellectuel. Cela aboutit à l’élaboration des « grandes synthèses scolastiques » (p. 99), dont saint Bonaventure (chap. 7) et saint Thomas d’Aquin (chap. 8) sont les plus illustres représentants. Si les deux insistent sur « l’unité dynamique de la sagesse chrétienne » (p. 111), le second « conçoit celle-ci sur un mode organique plus différencié, plus respectueux peut-être de l’autonomie épistémologique de chacune des disciplines », en particulier par le fait de reconnaître « à la philosophie une réelle autonomie, fondée, en dernière analyse, sur la consistance et la cohérence propre de la “nature” » (p. 115).
Mais le XIIIe siècle voit aussi l’émergence, à la faculté des arts, de « l’aristotélisme radical » (chap. 9), qui entend mettre en avant le modèle d’une vie proprement philosophique et faire reconnaître une place propre et autonome à cette dernière, pas forcément en rupture avec la foi chrétienne mais indépendante de celle-ci : « Leur préoccupation est plutôt de dégager, à l’intérieur d’une culture chrétienne, un espace de légitimité et de liberté pour l’idéal philosophique qui est le leur » (p. 139). L’A. mentionne les risques de déséquilibre introduits ainsi, et qui vont se déployer chez certains auteurs, comme Boèce de Dacie : « Pour lui, le projet théologique est suspect pour la bonne et simple raison que la philosophie s’attribue le monopole de la rationalité et de la science » (p. 144). Cela amène au « tournant de 1277 » (chap. 10), dont l’A. dégage les quatre grandes lignes problématiques marquant la fin de l’histoire philosophique médiévale. Il y a d’abord une critique par la théologie des possibilités de la rationalité philosophique, en particulier par le développement de l’argument de la toute-puissance de Dieu qui peut intervenir à chaque instant dans la nature en modifiant ou annulant ses lois, ce qui limite le champ de validité de la philosophie et des sciences. Il y a ensuite une indépendance croissante de la philosophie vis-à-vis de la théologie puisqu’elle n’a plus rien à dire sur la foi ni à harmoniser ses résultats avec elle. De plus, la théologie elle-même s’étant détachée de la philosophie, elle développe ses propres outils rationnels en une sorte de démarche parallèle sans lien avec la rationalité philosophique. Enfin, le criticisme prend souvent le pas sur l’élaboration doctrinale proprement dite : « Ainsi, entre ceux qui militent pour une philosophie indépendante, débarrassée des préoccupations théologiques, et ceux qui, au nom de la souveraine liberté de Dieu (ou d’une subjectivité humaine désormais déconnectée de la nature), abandonnent à la philosophie le domaine de la nature pour se réfugier dans la seule certitude de la foi ou de l’expérience intérieure, l’idéal d’une harmonie entre la foi et la raison semble perdue de vue » (p. 167-168).
Entre l’étude des deux plus grands penseurs du XIVe siècle, Duns Scot (chap. 11) et Guillaume d’Ockham (chap. 13), s’intercale un chapitre sur les deux courants qui vont se développer à la même époque chez les dominicains, le thomisme d’une part, la mystique rhénane de l’autre, héritière d’Albert le Grand, et dont la figure de proue est Maître Eckhart, l’A. signalant le caractère encore controversé que présente l’interprétation de sa pensée.
Avant un dernier chapitre consacré à la vie intellectuelle du XVe siècle, marquée par le passage « de l’Université à l’Académie » (chap. 15), où s’affrontent la via antiqua et la via moderna, et qui voit un retour triomphant du platonisme, l’A. présente une synthèse très intéressante de « la question théologico-politique au Moyen Âge », celle-ci offrant un champ d’application particulièrement symptomatique de la manière dont on conçoit les relations entre foi et raison.
Au total, si ce livre ne remplace pas les différents ouvrages généraux consacrés à cette période, en raison de son objectif clairement délimité, il a le mérite d’en exposer les grands courants et auteurs selon une perspective à la fois originale et centrale, dans un style limpide qui en rend la lecture facile et agréable. En cela, il est désormais une référence incontournable pour ceux qui veulent s’initier à la philosophie médiévale.
sr Marie de l’Assomption, o.p.